
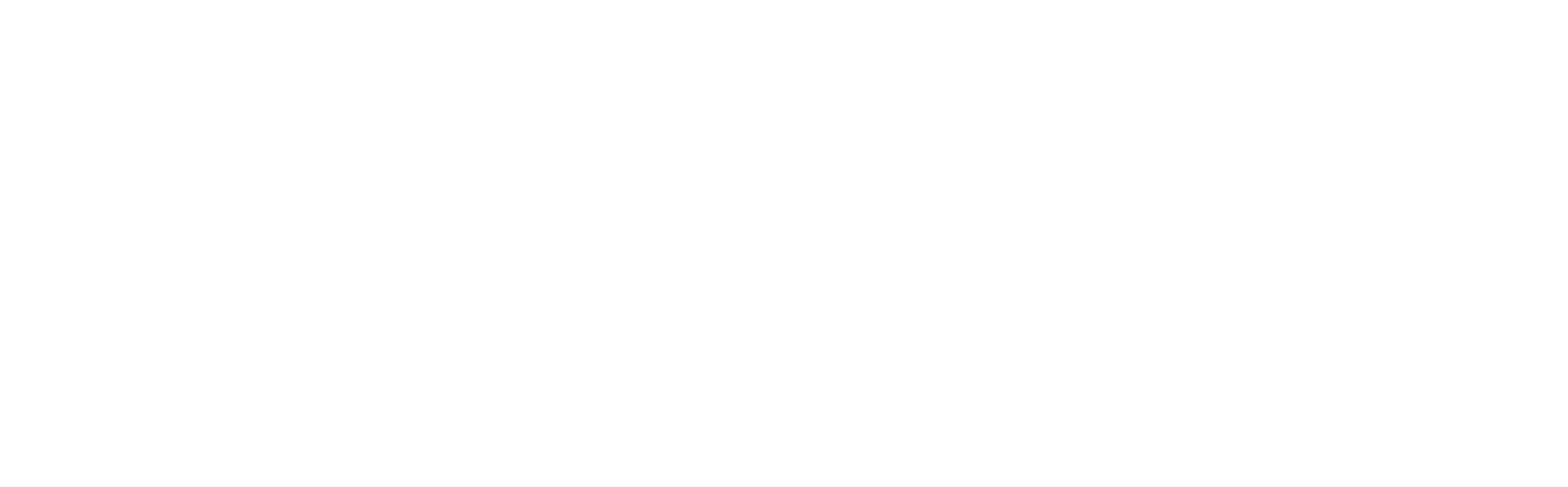
LES MOTS D'EDDY
Propos sur la chanson
Avant la découverte du disque, de la radio, de la télévision, avant même que n’existent les moyens de diffusions modernes, des chansons furent écrites qui connurent les succès et franchirent les siècles.
De « Plaisir d’amour » au « Temps des cerises », notre patrimoine abonde en exemples célèbres d’œuvres dont personne ne saurait s’approprier la paternité si ce n’est ceux qui les ont écrites. Il est évident, pour nous auteurs, que la création est un acte intime né de la rencontre d’une idée et de la main qui met sur le papier ou sur une bande magnétique et que tout ce qui peut se produire au-delà de ce geste n’est plus création mais utilisation.
À l’évidence, « Le lac des cygnes » est une œuvre de Tchaïkovski et non de Petitpas, même si ce chorégraphe génial sut lui donner forme et la marque de son talent.
Mais voilà : Petitpas n’aurait pas existé sans la musique et jamais Tchaïkovski n’eut à partager les droits de son ballet. Des centaines de chefs prestigieux ont dirigé les œuvres de Mozart sans pour autant exiger d’en être co-signataires.
Mais nous ne sommes plus au temps où l’on rendait à César…
Aujourd’hui, ceux qui utilisent nos œuvres, qui lui offrent un support ou un présentoir technique voudraient être considérés comme co-auteurs de l’œuvre sans laquelle leur talent ne pourrait s’exercer.
Il importe donc que quiconque veut accéder à la profession du spectacle sache qu’une fois pour toutes l’œuvre est une entité du moment où elle a été tirée du néant par ceux que l’on nomme les créateurs, que plus jamais elle n’aura d’autres concepteurs. Qu’une fois pour toutes les auteurs ont du talent et n’en ont pas, que tout le monde peut s’en servir mais que personne ne peut leur en prendre.
Il importe de savoir que l’œuvre, même dans un tiroir, même sur une étagère, reste une œuvre et la seule propriété de celui qui l’a écrite.
Et même si personne n’en était d’accord, si par protestation tous ceux qui véhiculent la chanson se mettaient un jour en grève, les auteurs, ceux qui méritent ce nom, sauraient toujours aller de ville en ville et de stade en stade pour se faire connaître.
Ils sont les descendants de Martini et de Jean-Baptiste Clément, qui ne jugèrent jamais utile de partager leur signature.
Discours – Légion d’Honneur
Je saluerai d’abord les proches collaborateurs de Monsieur Jacques Toubon, Ministre de la Culture, qui nous font l’honneur d’être ici ce soir.
S’ils sont présents, Jacques Blache n’y est pas étranger. « Il faut toujours remercier Jacques Blache ! » disait un jour, à juste titre, Gérard Davoust. J’ajouterai : « Si vous ne savez pas pourquoi, lui le sait ! ». Il semble que Jacques Blache soit né pour tisser des liens entre les gens. Disponible, dynamique, éclairé. En plus d’être un grand défenseur de notre cause, il est le sourire de la S.A.C.E.M. et nous avons beaucoup de chance de l’avoir avec nous.
Parce que je sais qu’il ne peut pas s’attarder, je voudrais exprimer à Henri Contet toute ma gratitude de débutant envers l’auteur célèbre qu’il était déjà. Ce débutant qui eut l’audace de lui faire grimper les trois étages de ses parents, rue La Fayette, pour lui faire entendre les chansons inconnues de l’inconnu qu’il était. Déjà comblé de ce qu’il ait pris la peine de m’écouter, j’étais bien loin de me douter qu’à quelque temps de là, lorsque je m’enhardis jusqu’à appeler des vedettes de l’époque, en disant timidement : « Vous ne me connaissez pas. Je m’appelle Eddy Marnay… », certaines voix me répondraient : « Mais je vous connais très bien. Henri Contet m’a parlé de vous ! ». Henri Contet, Président d’Honneur, donneur d’encouragements, grand seigneur au panache discret. L’Ami et l’un des plus grands auteurs de notre temps. Du lointain de ma jeunesse, je te dis : Merci !
Ma première Légion d’Honneur, je l’ai reçue le jour où mon père fut nommé Meilleur Ouvrier de France. J’avais douze ans, assis au premier rang de la Salle des Fêtes de la Mairie d’Alger dont les fenêtres s’ouvraient sur le bleu de la Méditerranée, ciel et mer confondus, et ce qui me transportait d’orgueil c’était non pas qu’il fût Meilleur Ouvrier, cela n’avait pas tellement de réalité pour moi, mais Meilleur ouvrier… DE FRANCE.
Pour nous qui étions nés Français sur une autre terre, ce mot – FRANCE – résonnait comme le nom d’une mère mythique, inaccessible, à laquelle nous appartenions sans la connaître.
Nos ancêtres s’habillaient à la Turque. La Terre qui nous avait enfantés était celle de Carthage, de Rome, dont Cherchell, Timgad, Tipasa conservaient les pierres, cette Maurétanie des Fatimides, des Almohades, des Almoravides qui était devenue un creuset turco-arabo-judéo-berbère lorsque, en 1830, sous le prétexte discutable d’un coup d’éventail, la France s’en empara.
D’où venions-nous ? Et comment ? Que pouvais-je avoir de commun avec un Limousin, un Tourangeau, un Franc-Comtois… ou même une Québécoise ? -Eh bien, la décoration de mon père, précisément, qui me faisait « DE France » comme Bois-le Prêtre, Chemin des Dames, voire Dardanelles et Gallipoli, les repères de « SA » guerre, celle de 14-18, dont ses récits submergeaient notre enfance.
Sans qu’il fut question de droit du sol ou de droit du sang, la France était notre fierté. Et c’est bien là le seul vrai critère.
Toute une vie, tandis que ma mère brodait des nappes à l’ancienne en fredonnant « La Paloma » ou la « Sérénade de Toselli » (au mépris des quotas français), j’ai vu mon père à son établi, visière de celluloïd bleu au front pour protéger sa vue du projecteur qui éclairait la bague, le bracelet, le pendentif ou le collier qu’il fabriquait de ses mains, pièce par pièce, motif par motif, découpant, ajustant, soudant, sertissant, guillochant, huit heures par jour – et plus -, vérifiant à la loupe chaque avancée de son travail, s’assurant qu’il n’avait pas commis d’erreur, comme pour m’indiquer la voie. Car moi, plus tard, reprenant chaque mot à la lumière de ma lampe, façonnant mes chansons « à la main », je finis par m’identifier à mon père et à me vivre comme un artisan. À cette différence près que lui ne pouvait pas se permettre de rater un bijou et que même ses déchets les plus humbles étaient toujours d’or ou d’argent.
Avant de quitter l’Algérie, je voudrais rendre hommage à quelques hommes venus de France dont les noms sont restés fidèlement attachés à ma mémoire. Ils s’appelaient Vallée, Marty, Laherre, Da Costa Rancillac… Ils respiraient le XIXème Siècle et les Belles-Lettres. C’étaient d’Honnêtes Gens imprégnés de Grec et de Latin à qui l’on avait confié la tâche redoutable d’être nos Professeurs de Français.
Dans ce beau Lycée d’Alger, baigné de soleil et de blancheur, ils devaient, souvent avec désolation, se heurter à une bande de babouins dont la Langue n’avait qu’un vague rapport avec celle de Châteaubriand. Ils eurent à affronter notre indiscipline caractérisée et la mauvaise volonté, l’opposition inconsciente de beaucoup d’entre nous qui se raccrochaient à leur jargon “couleur locale” comme à une identité dont on aurait tenté de les déposséder.
Moi, je leur dois d’être tombé amoureux de la Langue Française. Et j’ai pu être de ces quelques-uns -miraculés- dont les chansons ont atteint l’oreille et le cœur du public, c’est avant tout à ces hommes que je le dois, ces hommes d’une autre trame qui enseignaient comme on ne sait plus beaucoup le faire et qui se retourneraient dans leur tombe s’ils entendaient le langage qui se pratique, de nos jours, sur nos chaînes de radio et de télévision, aussi bien que dans nos rues et nos écoles.
Pierre Delanoë est l’initiateur de cette soirée. Je dois à l’amitié attentive qu’il m’a toujours portée d’être ici, rouge de plaisir et de fierté. Mais ma reconnaissance va plus loin que le respect et l’affection que nous avons toujours eus l’un pour l’autre.
Notre génération voyageait encore. Ses chansons gagnaient l’Amérique, l’Angleterre, le Japon. La Chanson Française était un navire qui touchait un peu tous les ports du monde, et la figure de proue de ce navire était Pierre Delanoë. Auteur-pilote de ce demi-siècle, Pierre le prolifique, prolifique parce que généreux, a su nous rendre envieux de son talent et nous insuffler un esprit de conquête. C’est peu dire aussi qu’un bon nombre de carrières de vedettes ne se seraient pas faites si elles ne s’étaient nourries de son invention et de sa fécondité.
Je n’hésiterais pas à dire que Pierre Delanoë est l’auteur symbole de notre temps. Même si cela devait heurter sa modestie légendaire.
De son vrai nom Le Royer, Pierre, il se prénomme aussi Charles, Manuel et… NAPOLÉON ! Un jour comme aujourd’hui ! Nous avons donc, sans le savoir, un lien secret puisque mon second prénom est DAVID ! C’est pourquoi, en dressant, au début de cette soirée, mon portait, il prenait de sérieux risques vis-à-vis de l’Histoire : “LE SACRE DE DAVID PAR NAPOLÉON”, c’est contraire à toutes les idées reçues. En le sacrant à mon tour, je n’ai fait que le replacer dans son cadre. Et je me sens soulagé !
Je n’ignore pas que d’autres ont souhaité pour moi cette distinction, comme d’autres ont voulu que j’entre au Conseil d’Administration et que j’en devienne le Vice-Président. Je veux citer des noms, et pardon pour ceux que j’oublierais : Claude Pascal, Jacques Demarny, Gérard Calvi, Max Amphoux, Louis Amade, Pierre Ribert, Gérard Davoust, merci !
Jean-Loup Tournier, j’étais déjà un de vos farouches propagandistes et j’étais déjà votre ami avant de vous connaître. Depuis ce temps, de beaux souvenirs nous ont reliés.
Jacques Larue, qui m’avait fait l’honneur et l’amitié de me considérer comme son dauphin, m’avait demandé de répandre le nom d’un brillant garçon qui représentait la S.AC.E.M. à New York, et qu’il fallait à tout prix faire venir à Paris.
À peu de temps de là, je me retrouvais face à vous et à Guy Magenta, balançant des coudes et des bras dans une… excusez l’expression… Discothèque ! Nos partenaires respectives, happées par les décibels et le délire ambiants, s’étaient volatilisées et nous étions là, tête-à-tête, gesticulant, parlant de twist en dansant sur des droits d’auteurs… à moins que ce ne fût le contraire.
Nous étions loin de nous douter alors qu’arriverait une époque, la nôtre, où les gens se trouveraient, comme par un vaste complot, dépossédés d’un de leurs droits le plus sacré : le droit au SILENCE ! Ascenseurs, avions, hôtels, restaurants, boutiques, grandes surfaces, cliniques, maisons du troisième âge… Plus jamais l’être humain n’a le droit de n’écouter que lui si bon lui semble, le droit de se recueillir.
Et c’est précisément alors que se pratique un abus pervers et indécent de la musique que l’on voudrait taxer la S.A.C.E.M. d’abus de position dominante, simplement parce que nous réclamons notre dû dans un monde qui ne SAIT plus tourner sans nous !
Et vous avez eu, ces quinze dernières années, Jean-Loup, Thierry de Surmont, comme les autres membres du Directoire et comme, finalement, tous ceux qui, dans cette maison, se vouent à notre cause, à subir le poids de cette guerre où, malgré Beaumarchais, malgré Napoléon… l’autre ! la mauvaise foi qui aurait pu marquer des points si vous n’aviez été, comme toujours depuis quarante-deux ans, en première ligne.
Merci donc à tous ceux qui, à Paris comme en Province, nous protègent et nous défendent. Il m’est impossible de citer tous les noms qui me viennent à l’esprit.
Alors ce soir, exceptionnellement, et puisque la distinction dont je fais l’objet n’est pas sans lien avec ma mission au Québec, permettez-moi de les rassembler tous en la personne de l’un d’entre eux dont on parle trop peu, et pour cause, puisqu’il n’est presque jamais là. J’ai nommé Jacques DUPONT, notre Hollandais Volant. Vous le trouverez aux États-Unis, en Argentine, en Australie, en Argentine, en Suède, en Argentine, partout et en Argentine… Mais surtout, il est celui qui, les deux pieds dans ces fameux arpents de Neige, a aidé nos amis québécois à édifier cette S.O.D.R.A.C. qui, au fil des années, m’est devenue aussi chère que la S.A.C.E.M.
Dans un pays où le Droit d’Auteur fut longtemps ignoré, méprisé, bafoué, la S.O.D.R.A.C. est née de la québécoise S.P.A.C.Q., ce sigle qui claque comme un coup de fouet, et de la S.A.C.E.M. qui sonnerait plutôt comme un clavecin bien tempéré. D’un côté, des mousquetaires à l’assaut d’une forteresse arrogante et hostile, de l’autre un homme, Jacques DUPONT, porteur d’une méthode et de deux cents ans de tradition qui fut souvent le conseiller, le point de référence, palliant quand il le fallait la fougue et l’impatience d’une poignée de vaillants guérilleros : Lise Aubut, Claudette Fortier, qui savourent les délices de l’Eté Indien, tandis que Luc Plamondon, le flamboyant, et François Cousineau, le raisonneur, sont ici ce soir pour ma plus grande joie.
Il est très enrichissant et très réchauffant de constater, à l’occasion d’un évènement comme celui-ci, que l’amitié ne connaît pas les distances.
Celle dont je veux vous parler vient de faire 6.000 kilomètres, spécialement pour me voir pâlir devant cette audience à la fois familière et impressionnante. Elle a été l’âme porteuse, la Passionaria du Droit d’auteur au Québec. La S.P.A.C.Q. est pratiquement née dans sa belle cuisine rustique autour d’une machine à Capuccino dont elle a tendance à abuser. Auteur-Compositeur-Interprète de grand talent, elle est aussi une femme au grand cœur dont l’amitié m’est chère. Diane Juster ! Elle a le sens de l’humour car, dans son pays où le rôle de l’Éditeur est encore mal défini et où les droits, malgré tous nos progrès, ne sont pas encore très substantiels, elle a créé ses propres éditions qu’elle a appelées : Les Éditions “Par principe”
Elle a aussi le sens de la guerre car elle s’est juré un jour de ne plus adresser la parole au Président d’une chaîne de Télévision, par ailleurs son ami, tant que celui-ci n’aurait pas accepté le “deal” de 400.000 dollars par an qu’elle avait négocié en compagnie de Lise Aubut et Claudette Fortier. Il a payé… elle lui a reparlé ! J’étais à leur table le soir de leur “rabibochage”.
Merci Diane, Luc, François. Vous m’apportez, non seulement votre présence, mais aussi une bouffée de ce Québec où j’ai trouvé, grâce à vous, à Céline Dion et René Angélil, Mario Pelchat et bien d’autres, un second souffle.
Ce Québec où l’on porte si haut et si fièrement la France, où l’on se bat et où l’on gagne, où l’on donne l’exemple de ce qu’il faut faire pour sauvegarder notre langue, quitte à la massacrer un peu au passage, ce Québec où moi, l’Ancêtre S.A.C.E.M., je suis redevenu Pionnier S.O.D.R.A.C… Mais je m’aperçois que ces deux mots ont pratiquement le même sens.
Je suis décidément privilégié, car quelqu’un d’autre a fait, lui dix mille kilomètres pour être à nos côtés. New Yorkais de Californie, cette maison est un peu la sienne. Elle a vu passer beaucoup de ses titres, de grands succès, de belles chansons aux textes élégants et précis qui me font penser à cette très belle formule : “Il n’y a de poésie véritable que dans l’exactitude des mots.”
Norman Gimbel est un des plus grands paroliers de son pays. Il a écrit, entre autres, “Killing me softly”, “The Girl from Ipanema”, “Bluesette”, l’adaptation des “Parapluies de Cherbourg”. Il a obtenu un Oscar à Hollywood, s’est vu ouvrir le “Hall of Fame” le “Temple de la Renommée”, consécration suprême du Show Business américain. Il est venu, non pas de dix mille kilomètres, mais de trente ans d’amitié.
Permettez-moi pour un instant, sans trahir les quotas français, de lui adresser quelques mots de bienvenue : Dear Norman, I just told a few bad things about you, as you can imagine, for example that you were a great talent and also that you didn’t come from six or seven thousand miles away from here, you came from thirty years of a warm and cloudless friendship and you added one more joy to this unique event that will remain unforgetable to me. Thanks Norman, thanks a lot and all my love.
Je voudrais remercier Jean-Claude et Mania Calon, Derek et Katherine Glynn, eux aussi venus de loin. Les compositeurs, les éditeurs, mes confrères auteurs qui, en démontrant beaucoup de talent, m’ont aidé à en avoir aussi, mes interprètes, tous ceux qui m’ont fait confiance et m’ont accompagné aussi bien sur les autoroutes que sur les chemins caillouteux de “cette grande petite chose”, comme disait Léo Ferré, qu’est la Chanson.
Remercier spécialement Renée Lebas parce qu’elle fut la première à me faire confiance, à me prêter sa magnifique voix et à me faire ré-écrire, à juste raison, une dizaine de fois mon premier texte… jusqu’à ce qu’il reste inchantable !
Je veux exprimer mon affection et ma reconnaissance à tous ceux de ma famille, présents ou absents : Frères, belle-sœur (ou belles-sœurs), neveux, cousins-cousines germains ou non qui, en suivant le long déroulement de ma carrière du même œil attentif qu’ils avaient à mes débuts m’ont maintenu peut-être en état de vigilance et aidé au-delà de ce qu’ils peuvent imaginer, car le salaire le plus précieux d’un créateur, c’est bien la reconnaissance des siens, pairs, amis ou parents. Et je n’en ai jamais manqué.
Cette maison où nous sommes est devenue la mienne, non pas parce que j’y perçois mes droits, mais parce qu’elle contient ma famille d’élection. Au-delà de toutes les récompenses, la réussite d’un homme est affective… ou alors elle n’est pas.
Je n’oublierai pas la blondeur québécoise qui, depuis plus de treize ans, est entrée dans ma vie et dans mes chansons au point de les connaître et de les protéger mieux que moi. Je lui suis reconnaissant au-delà de toute expression des liens qu’elle a su tisser avec ma fille, absente ce soir, à mon grand regret. Je lui dois beaucoup. J’honore ses parents et c’est une grande partie de moi-même qui est ici ce soir avec elle.
J’ai commencé en vous parlant de mon père. C’est par lui et par celle qui partagea sa vie que je terminerai.
Cet artiste au talent incomparable eut un jour la malencontreuse idée d’ouvrir boutique à côté de son atelier. Meilleur Ouvrier de France à son établi, il était à son comptoir, tout sauf un commerçant et allait jusqu’à oublier le prix de revient de ses bijoux, de son loyer, de son gaz et de son électricité pour peu qu’un client s’émerveillât de ses créations. Ses prix de vente étaient inversement proportionnels à l’enthousiasme de l’acheteur et, pour peu qu’il s’agît d’un chanteur ou d’une chanteuse de l’Opéra, dont son magasin était proche, ils descendaient à zéro, au grand désarroi de ma mère, qui essayait en même temps de tenir les comptes et de nous maintenir à l’écart des difficultés.
Cela tenait du ballet aérien, mon père étant le funambule qui tombait souvent sans le savoir, car ma mère était là, miraculeusement pour le recueillir dans un filet invisible.
Mon père était depuis soixante-dix années à son établi. Il travaillait dans une pièce de leur appartement, car il n’aurait pas su vivre sans faire vivre ses mains, mais ne vendait plus rien depuis longtemps. D’autres produisaient industriellement les mêmes bijoux que les siens pour un prix infiniment moins élevé.
Ils reçurent un jour la visite d’un Inspecteur des Finances. Contrôle fiscal. J’étais venu à la rescousse. L’Inspecteur demanda sans préambule à voir leur comptabilité. Ma mère sortit d’un tiroir un superbe agenda des Galeries Lafayette dans lequel l’Inspecteur lut (je lisais par-dessus son épaule) :
- Achat 1 Kilo matière argent ….. 25.000 F. (anciens)
- Achat soudure argent ……………. 2.000 F.
- Contrôle de la Garantie …………. 4.000 F.
- 2 kilos de tomates ………………….. 6 F.
- Radis, ail persil ……………………….. 5 F.
- Chaussures Gaston ………………..
Point d’exclamation, point d’interrogation dans l’œil de l’Inspecteur, qui a l’air de me demander si on se moque de lui, mais la stupeur me rend indéchiffrable. Il se tourne alors vers ma mère et trouve la douceur même, le sourire épanoui d’un jeune écureuil, satisfaite de la bonne tenue de son agenda à la couverture fleurie.
Quant à mon père, débonnaire, hospitalier, je jurerai – je redoute – qu’il ne soit sur le point de dire : “Vous prendrez bien l’anisette avec nous ?”
L’Inspecteur les observe, perplexe, me regarde, puis prend le chemin de la sortie en disant : “Bon, tout est en règle”. Et il emporte avec lui un mystère… ou une certitude. Je ne sais.
Voilà mes parents. Bons, rares, simples, grands. Ce soir, si vous le permettez, c’est à eux que je remettrai mon ruban.
À ma fille Celia aussi, qui l’a bien mérité.
Demain, il sera à ma boutonnière.
Discours – Club Rotary
Il est aussi difficile, dans le monde où nous vivons, d’entendre un Français bien parlé que de rencontrer un vrai Chrétien.
Et ce n’est pas par provocation que j’emploie cette comparaison. Je pense simplement que la langue est ce qui “relie” un peuple à son identité et qu’à ce titre, elle est une Religion. On ne peut pas piétiner sa langue sans y laisser son âme. Les civilisations meurent de négligence et, sur ce plan, les choses sont en bonne voie pour nous.
La radio, la télévision, à quelques exceptions près, baignent dans un Français assassiné qui n’a pas l’air de révulser les directeurs des chaînes, qui ont eux-mêmes – pour ce qui est du réseau national – l’approbation de ministres dont certains, dans un passé très récent auraient pu, sans détonner, être présentateurs de radio ou de télé.
Et pourquoi ne pas tourner un regard interrogatif vers un chef d’État dont chacun, toutes tendances confondues, s’accorde à dire qu’il est un homme de haute culture ?
J’aime assez voir certains fossoyeurs prôner la simplification de l’orthographe. On n’a plus besoin de la simplifier puisqu’elle a disparu.
J’en vois d’autres se scandaliser de l’arrivage constant de termes anglo-saxons, mais on ne parle de rien si l’on ne parle d’abord de syntaxe. La bonne tenue de la maison commence par une “mise en ordre”. Eh bien “mise en ordre”, c’est précisément ce que signifie étymologiquement le mot “syntaxe”. Mais si on ne l’apprend pas à nos enseignants de base, comment pourraient-ils, à leur tour, le dire à leurs élèves ?
Et comment l’édifice peut-il tenir dès lors qu’on l’a amputé de ces ceux piliers de base que sont le Latin et le Grec ?
Gommer l’étymologie revient à scier un arbre généalogique.
Nos parents nous parlaient de leurs grands-parents et nous faisaient aimer des êtres que nous n’avions pas connus. En éclairant nos origines, ils fortifiaient nos racines. Comment peut-on méconnaître de telles évidences ? Le Français qui sillonne la terre appartient à sa langue autant qu’à ses ancêtres. Et il ne la connaît plus.
On ne cesse de parler de l’avenir de l’homme, mais comment va-t-on vers l’avenir si ce n’est à partir de ses origines. Cela revient à ne tirer l’élastique que d’un seul côté. Quelle tension de l’être peut-on espérer, et vers quel but si on en fait une île flottante ?
Le dialogue de notre pays se nourrit du squelette désarticulé de ce qui fut autrefois le Français. On ne sait plus construire une période, ni même une phrase ; le vocabulaire s’amenuise jusqu’à la débilité, il tourne autour de superlatifs insignifiants, d’apocopes, d’aphérèses vulgaires, d’adjectifs impropres rarement reliés à un substantif autour d’un mot : “problème” qui en a bien aboli et remplacé une centaine d’autres, de verbes absents. Le tout vire à l’onomatopée, au borborygme, à l’éructation et vous avez pu constater, comme moi, ces jeunes Français de souche dont l’entrevue au journal télévisé était sous-titrée… en français ! Ils n’étaient ni immigrés, ni résidents, ni de quelque Dom-Tom. Ils étaient d’ici, nationalistes et xénophobes de surcroît, mais leur français inarticulé offensait à tel point les microphones qu’il fallut le donner à lire.
Et tout cela dans une époque où, par la grâce des médias, tout le monde prend la parole, ce qui jamais dans l’histoire du monde ne s’était produit.
Quand nos humoristes veulent nous faire rire de l’accent africain, ils ne se doutent pas qu’en réalité ils nous donnent une leçon de Français, car leur caricature naît toujours d’une application tatillonne à ne pas transgresser nos règles grammaticales. C’est dans notre pays que se pratique désormais le “petit nègre” que nos colonisateurs tournaient en dérision. L’homme remonte dans l’arbre au moment où, plus que jamais, il faudrait qu’il en descende. Si encore c’était son arbre généalogique !
Ceux qui sont censés gouverner, donc prévoir, ont fait un faux calcul en sacralisant l’ordinateur. Ils ont mathématisé les cerveaux en prévision d’un “marché du travail” qui, à tout jamais, refusera du monde puisque l’ordinateur en occupe la plus grande partie et détruit toute aspiration à l’artisanat, voire à la débrouillardise, qui ont toujours été et pourraient encore être créateurs d’activités.
Au passage, ils ont mis le Français aux oubliettes, démantelé le patrimoine et fait une hécatombe de “demandeurs d’emplois” spécialisés dans l’inculture.
Ils mènent un faux combat ceux qui s’horrifient de l’intrusion dans notre langue de mots comme parking, shopping, week-end, jogging. Ou alors il faudrait renoncer à bistro, taxi, sucre, pyjama, châle, turban, opéra, thé, divan, chocolat, redingote, tarif, coton, chocolat, amiral et sept mille autres de toutes origines autres que le Latin et le Grec, dont nous avons bien eu raison de nous enrichir au cours des siècles.
Rappelons-nous qu’en anglais, cette langue dont, de mauvaise foi, on veut faire la cause de nos déboires, les mots se terminant en “ion” (sensation, illusion), en “ité” (fraternité, identité), en “logie” (graphologie, pathologie), en “ophie” et “graphie” (philosophie, biographie), en “able” et beaucoup d’autres viennent tous de notre langue.
Rappelons qu’intellectuel se dit “intellectual”, que certain se dit “certain”, que lumineux se dit “luminous”, et que costume se dit “costume”. Sait-on que tennis vient du “tenez !” que l’on prononçait en servant au Jeu de Paume ?
Sait-on que les Anglo-Saxons ont, dans leur langue, trente-sept mille mots français, au point que Louis-Philippe disait : “L’anglais est un squelette d’Allemand habillé de Français” et Victor Hugo : “L’anglais est du Français mal prononcé.”
Alors, si l’anglais nous revient, tant mieux ! Il nous doit une grande partie de sa richesse. Et si quelquefois nous avons recours à lui, lui ne peut se passer de nous. À nous de savoir réintégrer notre langue quand le terme anglais a une contrepartie et souvent une origine française tout aussi valables. Cela, Jacques Toubon l’a très bien compris.
Comme tout corps vivant, une langue a besoin de se nourrir, de s’ouvrir aux apports extérieurs. C’est ainsi qu’on augmente son trésor. Mais pour les digérer et les intégrer sainement, elle doit d’abord être bien parlée par ceux qui en ont la garde, faute de quoi elle se transforme en dépotoir.
Je m’irrite plutôt de voir notre langue contre-accentuée par certains bateleurs de radio et de télévision qui mettent systématiquement l’accent tonique sur la première syllabe afin de lui donner une intonation anglo-saxonne. C’est triste, parce que la musique d’une langue, c’est aussi son âme.
Je m’irrite aussi de voir notre vocabulaire se rétrécir et certains mots en assassiner quelquefois des centaines d’autres. Un seul d’entre eux, le mot “problème” n’est déjà pas loin d’avoir rayé de la carte les mots question, énigme, interrogation, devinette, charade, rébus, difficulté, embarras, tourment, tracas, épreuve, embarras, péril, impasse, aléa, obstacle, dédale, pour n’en citer que quelques-uns.
Et que dire d’un ministre des transports qui laissa les murs de nos villes se couvrir un jour de cette formule étonnante : “Je roule cool”. Ceux du métro s’orner de cette autre perle : “La RATP recrute des agents de maîtrise. Entrez dans le métro, c’est pro.”
Je faisais, en commençant, un parallèle entre langue et religion. J’en ferai un tout aussi important entre langue et famille.
Écoutez bien la langue qui se parle et vous y trouverez quelque chose qui n’est pas sans rapport avec la brisure du lien familial. Je veux parler de l’usage systématique du hiatus dans le parler quotidien. Le hiatus est une fausse note voulue. Il est le rejet systématique de la consonne d’appui qui fait “liaison”. Mais ce mot “liaison” n’est-il pas de la même origine que “relier” et “religion”. Et “consonne” ne signifie-t-il pas “sonner avec” ? Toutes notions qui évoquent une harmonie de liens familiaux et ces liens, il est évident qu’on les maintiendrait en disant : “Il était “tune” fois” ou “c’est “tun” ami”, mais qu’on les rompt délibérément en disant “Il “étai” une fois”, “c’é un ami”, le “di” octobre, “cen” entreprises “on” été créées…” Autant de laideurs qu’on crache au visage de Descartes, Montaigne, Voltaire ou Proust qui étaient des pères et qui respectaient les liaisons. Le hiatus n’est pas que rupture. Il est le commencement de la discorde.
Mais l’âme humaine a des bizarreries qui me surprendront toujours. Quand d’aventure un sursaut de purisme semble se manifester, comme ce fut le cas au moment de la Guerre du Golfe, on aboutit à des étrangetés telles que : “Les sirènes ne prennent personne “tau” dépourvu…” “Ce n’est pas un souhait, mais bien “zune” réalité”, “Je crois qu’ils doivent savoir que l’Irak fait partie de la nation-Zarabe”, “Chaque unité au combat passe “t’en” principe…”Oublions par charité que deux soldats alliés morts au combat étaient “respectueusement” âgés de 24 et 32 ans” pour ne retenir qu’un sursaut réconfortant, mais hélas maladroit et de courte durée.
Je voudrai terminer, puisque je suis d’abord un auteur de chansons, par une anecdote professionnelle en forme de parabole.
J’avais écrit, pour les 75 ans de Maurice Chevalier, une chanson qui s’intitulait “Qu’est-ce qui r’vient ?”.
Un dimanche en matinée, en compagnie de Mireille qui en avait écrit la musique, je vais à l’Alhambra écouter le tour de chant du grand Maurice qui nous reçoit ensuite dans sa loge, en peignoir de bain, serviette éponge autour du cou, pieds nus dans des pantoufles.
Entretien cordial, bonhomme, dont je sors ravi. Chevalier était pour moi une légende. Mais Mireille me dit : “Je n’ai pas aimé la façon dont il s’est débarrassé de nous. Il nous a carrément mis à la porte.”
Je ne partageais pas cette impression. Je ne m’étais pas senti éconduit, bien au contraire, mais il faut connaître Mireille, merveilleuse musicienne, mais attentive jusqu’à être un peu soupçonneuse. Elle me prend par la main, me dit : “Je veux en avoir le cœur net, venez avec moi.”
Et me voilà tapi (si j’ose dire) derrière un rideau, guettant je ne sais quoi, mal à l’aise. Or Mireille avait eu un juste pressentiment. Trois minutes ne s’étaient pas écoulées que nous voyons Maurice Chevalier apparaître en smoking, canotier à la main, faire le parcours du fond de la scène au micro, puis du micro au fond de la scène, puis du fond de la scène au micro. Bref, à 75 ans, après plus de 60 ans de métier, Chevalier réglait encore le nombre de pas exacts de son entrée et de sa sortie de scène. Et en chaussures vernies, car on ne marche pas de la même façon en chaussures vernies qu’en Charentaises ! Après quoi il s’en retourna dans sa loge pour se remettre en peignoir et pantoufles, en attendant la représentation de 21h.
Qu’est-ce que cela veut dire et quel rapport me direz-vous avec la langue française ?
Eh bien, dans un music-hall (mot anglais) où traditionnellement les chanteurs se produisaient en tourlourous, clochards, clowns, quand ce n’était pas en lavallière, Maurice Chevalier avait introduit dans les années 20, un accoutrement nouveau, le smoking (autre mot anglais), mais que, soucieux des règles de son métier, cinquante ans plus tard il en respectait l’ordre, c’est à dire la syntaxe.
Dans un monde en débandade où l’on parle beaucoup d’Ordre Nouveau sans jamais plus être capables de nous entendre entre nous, la première urgence serait de refaire notre École en donnant la prépondérance au premier de tous nos biens communs : la Langue Française.
Discours – Sur la chanson
Je me suis souvenu qu’au début, quand je disais que j’écrivais des chansons, on me demandait toujours : “Mais, à part ça, que faites-vous pour gagner votre vie ?”. Il subsiste toujours une question à notre sujet dans l’esprit du public, c’est que la chanson est une des choses les plus indéfinissables qui soient.
Des paroles, de la musique. “Chansons que tout cela !” disait Molière avec mépris dans “l’École des maris.”
Léo Ferré rétablissait l’équilibre en parlant de “cette grande petite chose, la chanson.”
Il est vrai qu’aucun événement de notre vie, de l’Histoire même, ne peut se trouver dissocié d’une chanson. Et à mesure que l’on vieillit, la chanson vient d’abord, et le souvenir la suit.
Pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu’il y a toujours eu des auteurs et des compositeurs qui étaient “de leur époque”, c’est à dire qui n’étaient arrivés ni trop tard ni trop tôt, et qui se sont trouvés là pour capter l’air du temps. Des mediums en quelque sorte !
Comment expliquer autrement, – non pas la chanson, – mais le “succès” de la chanson ?
Il y a 40.000 auteurs à la S.A.C.E.M. 1000.000 chansons s’y déposent par an. 12, 15, 20 deviennent des succès et rencontrent la faveur du public. Faites la part du déchet et dites-moi si ce n’est pas un miracle que je me retrouve aujourd’hui dans cet Hôtel Raphaël à vous parler, à vous, membres du Rotary, de quoi ? De chanson.
Enfant, je m’émerveillais de toutes ces vedettes que mon père m’emmenait voir et entendre au Music-Hall. Mes rêves se peuplaient de Fred Astaire et de ces bouquets de girls superbes que Busby Berkeley nous offrait par myriades dans la virtuosité diabolique de ses jeux de miroir.
J’ignorais alors qu’un jour j’approcherais ces vedettes mythiques, que je leur parlerais, que je les toucherais et que je m’exprimerais à travers elles.
Lorsqu’on posait à Cole Porter la question : ¨Qu’est-ce qui vient en premier : les paroles ou la musique ?”, il répondait : “Oui”.
Cela veut dire qu’on ne sait jamais comment va naître une chanson. Et quand elle commence par la musique, d’où vient que se retrouvent sur le papier de l’auteur les mots “Croquemitoufle”, “La Place Rouge était blanche”, “Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver” ou “Un oranger sur le sol Irlandais…”
Croyez-moi, le premier surpris, c’est l’auteur qui se demande ce qu’il vient de pondre et ce qu’il va bien pouvoir dire ensuite.
Le talent, dans notre métier comme partout ailleurs, est la chose du monde la mieux partagée. S’il fallait le chiffrer dans la réussite d’une carrière, je dirais qu’il représente 10 % et que le reste est transpiration, ce mot que j’ai appris à bannir de mon vocabulaire.
Si vous en voulez un exemple, je vous citerai celui de Maurice Chevalier pour qui j’avais écrit, à l’occasion de ses soixante-quinze ans, une chanson intitulée “Qu’est-ce qui r’vient ?”
Un dimanche en matinée, en compagnie de Mireille qui en avait écrit la musique, je vais à l’Alhambra écouter le tour de chant du grand Maurice qui nous reçoit ensuite dans sa loge, en peignoir de bain, serviette éponge autour du cou, pieds nus dans ses pantoufles.
Entretien cordial, bonhomme, dont je sors ravi. Chevalier était pour moi une légende. Mais Mireille me dit : “Je n’ai pas aimé la façon dont il s’est débarrassé de nous. Il nous a carrément mis à la porte.”
Je ne partageais pas cette impression. Je ne m’étais pas senti éconduit, bien au contraire, mais il faut connaître Mireille, merveilleuse musicienne, mais attentive jusqu’à être un peu soupçonneuse. Elle me prend par la main, me dit : “Je veux en avoir le cœur net, venez avec moi.”
Et me voilà tapi (si j’ose dire…) derrière un rideau, guettant je ne sais quoi, plutôt mal à l’aise dans ma peau d’espion. Or Mireille avait eu un juste pressentiment. Trois minutes ne s’étaient pas écoulées que nous voyons Maurice Chevalier apparaître en smoking, canotier à la main, faire le parcours du fond de la scène au micro, puis du micro au fond de la scène, puis du fond de la scène au micro. Bref, à 75 ans, après plus de 60 ans de carrière, Chevalier réglait encore, comme beaucoup de débutants ne penseraient pas à le faire, le nombre de pas exact de son entrée et de sa sortie de scène. Et en chaussures vernies, car on ne marche pas de la même façon en chaussures vernies qu’en Charentaises ! Après quoi il s’en retourna dans sa loge pour se remettre en peignoir et pantoufles, en attendant la représentation de 21h.
Le public, lui, ne sait pas cela. Il subit le charme éclatant du sourire de Chevalier et croit que le reste vient naturellement.
Je veux vous raconter aussi l’histoire d’Yves Montand qui nous reçoit un matin, Émil Stern et moi, sortant du lit, pieds nus, cheveux ébouriffés, vêtu d’une robe de chambre écossaise et refuse la chanson que nous lui apportons en nous disant : ” Non, ce n’est pas de cela que j’ai besoin. J’ai un trou dans mon tour de chant… Tenez, je vais vous montrer !” Et le voilà qui, dans cette tenue aussi peu “star” que possible (des claquettes en pieds nus, imaginez-vous) nous donne une heure et demie du spectacle le plus surréaliste qu’il m’ait été donné de voir. Tout un tour de chant tour à tour tendre, étourdissant et, parvenu au paroxysme de la virtuosité, il s’arrête, essoufflé, et nous dit : “Voilà. Je viens de bouger beaucoup. Le public en a assez. Moi aussi. Parvenu à ce point, il me faut un moment de confidence, il faut que les lumières s’éteignent, que je n’aie plus qu’un spot sur moi, que je reste immobile, apaisé devant mon micro.”
Et, ce disant, il laisse tomber sa tête sur sa poitrine, comme épuisé.
Je lui dis : “Ta chanson est faite !”
Nous sommes, nous paroliers, les premiers pas par qui la langue française parvient, à chaque heure du jour et de la nuit, aux oreilles du public. Nous avons donc le devoir de peser nos mots même et surtout si la chanson est un art populaire.
– Mardi, 5 avril 1994.
Discours – Spectacle hommage
Je serai ce soir un spectateur émerveillé.
Émerveillé de ce qu’une note soit un dessin sur un papier et que ce dessin se transforme en son. Que ce son, en tintant, déplace les choses ou les remette en ordre.
Émerveillé de ce qu’un mot posé sur un son puisse le prolonger, l’emporter jusque dans les replis les plus secrets de l’âme collective et lui faire franchir des seuils d’espérance, de tendresse ou de mélancolie.
Émerveillé d’être le fils de ce père qui, par-dessus tout, aimait chanter. De cette mère qui soupirait “La Paloma” en brodant des nappes à l’ancienne dans son fauteuil à bascule.
Émerveillé de ce qu’à des milliers d’encablures des Côtes d’Armor, par-delà la symphonie de l’Atlantique, existe une terre grandiose où des gens parlent la langue que j’écris, vibrent aux émotions qui, un jour, ont fait trembler ma main et m’ont fait tisser sur des navires de musique des voiles de paroles qu’un vent magique a porté jusqu’à leurs rivages.
Émerveillé de ce que le Québec soit une partie de moi et qu’à Trois-Rivières, Joliette ou Hochelaga, des passants me sourient parce qu’une voix de chez eux s’est emparée de quelques phrases qu’une source invisible a fait surgir du fond de ma mémoire.
Je serai ce soir le seul spectateur d’un spectacle dont vous serez les acteurs. Vous allez jouer à chanter, à écouter, à vivre “Cent Mille Chansons” et je guetterai, comme l’oiseau contemple sa couvée, la naissance d’un moment où vous et moi ne ferons plus qu’un, où le miracle après lequel j’ai couru toute ma vie s’accomplira comme la chose la plus simple du monde, parce que vous et moi ne savons pas vivre sans aimer et être aimés.
Il y fallait cependant la volonté, le talent et l’amitié de quelques-unes, de quelques-uns qui ont voulu ce moment, l’ont préparé avec l’ardeur que les artistes (et nous sommes tous des artistes) savent mettre dans ce qu’ils projettent, dessinent et délivrent quand le cœur a parlé et que plus rien ne peut arrêter le cours de leurs élans.
Il y fallait enfin le souffle d’une jeunesse, belle à supprimer le temps, les modes et les frontières.
Je m’adresse à ceux qui m’offrent cette soirée, que je vais découvrir comme on ouvre un paquet-cadeau, car ils ne m’ont rien dit de ce qu’ils allaient nous donner à voir.
Je serai ce soir un spectateur comblé, ému et plein de reconnaissance…
Témoignage – Yves Montand
Il faut croire que les chansons mentent quelquefois, car la mer ne parvient pas à effacer sur le sable les pas d’Yves Montand, et ses feuilles mortes ne sont pas près de mourir.
Il en a tant semé sur la route qu’ici et là, ici ou là, en l’An 2000 et bien après, il se trouvera toujours quelques ancêtres ou quelques enfants pour en saisir une au vol et la faire repartir vers des lèvres inconnues qui, désinvoltes, un peu distraites, en ignorant le nom de l’auteur, lui feront le don miraculeux d’un renouveau d’éternité.
Yves a tellement habité son temps, et ce temps fut si riche d’Histoire qu’on ne pourra plus évoquer son Mur, des Partisans, ou simplement Paris et ses îles, sans y mêler son image et sa voix.
Il y a les chanteurs qui chantent et ceux qu’une baguette invisible a mués en messagers du siècle. Yves Montand est de ceux-là. Porteur de nos rires, témoin de nos épreuves, il ira aussi loin que peut aller l’inconstance mémoire des hommes, qui sait pourtant reconnaître les arbres auxquels elle s’attache.
– Neuilly, 19 décembre 1991
